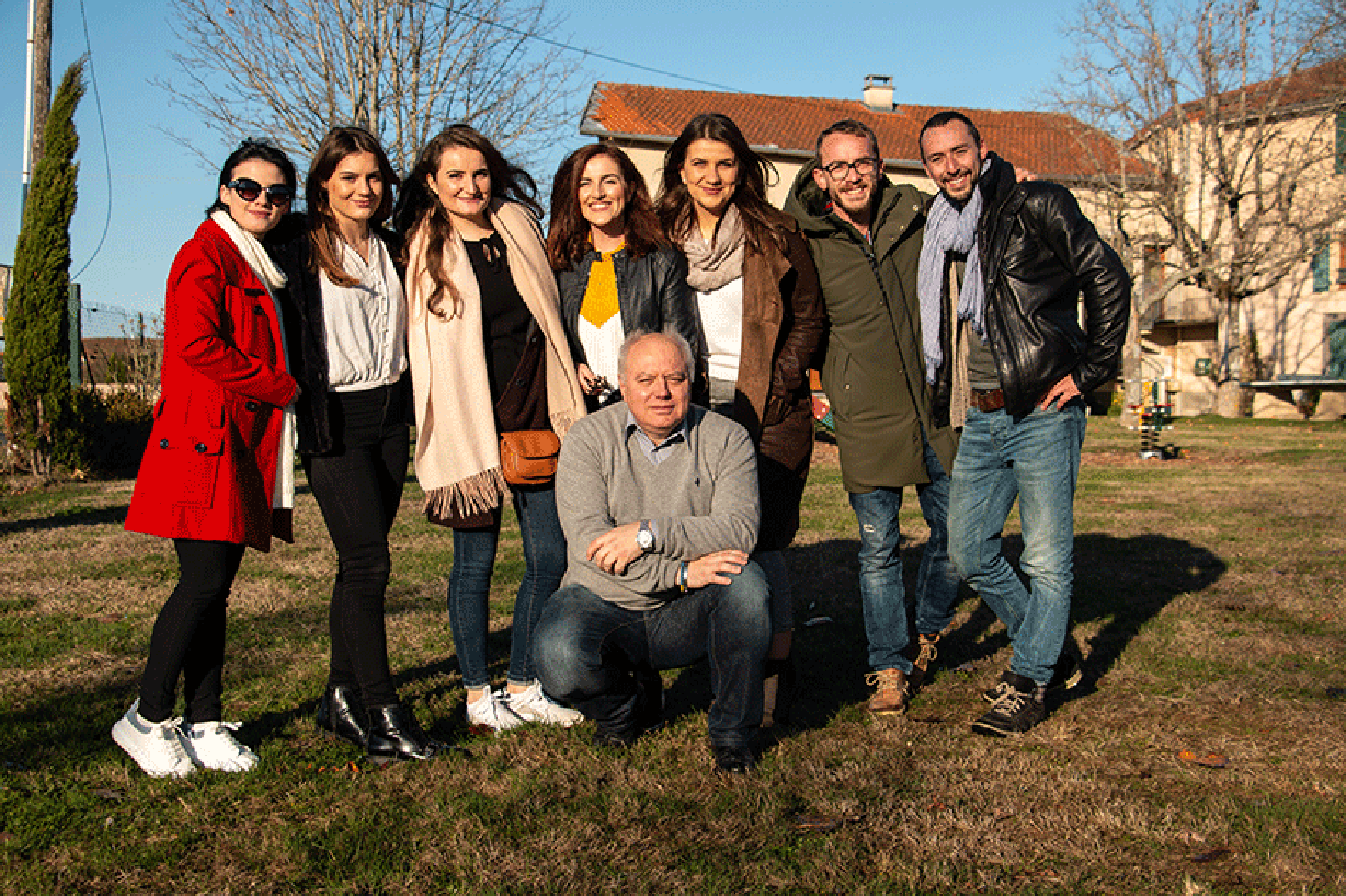Une jeunesse bosnienne en fuite
Depuis la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, plus de 100 000 jeunes auraient quitté la Bosnie-Herzégovine. Le manque de perspective d’avenir, le chômage élevé, la corruption et le non-renouvellement de la classe politique ont créé un sentiment d’égarement chez la jeunesse bosnienne.
Sur le toit du centre culturel Abrašević à Mostar, le vent vient soulever les cheveux et rafraîchir les visages où perlent quelques gouttes de sueur. Il est 18 heures, et la température affiche encore 34 degrés. La musique électronique s’échappe des enceintes postées sur la terrasse et se mélange aux bribes de conversations. Amar Maksumić, 21 ans, grand brun aux yeux bleus et membre du centre, nous accueille dans ce fief alternatif où il passe la plupart de son temps. Des graffitis décorent les murs. Des containers font office d’atelier de sérigraphie sur t-shirt ou de salle de répétition pour les artistes. Le centre culturel OKC Abrašević est un lieu d’échange et de rencontres qui propose à l’année tout type d’événements : concerts de musique, projections de films, expositions mais aussi du théâtre, des conférences, des débats ou encore des ateliers d’expression artistique. L’espace a rouvert en 2006 après plusieurs années de fermeture à cause de la guerre.
Situé dans la rue Aleksa Šantić, le centre culturel Abrašević possède une symbolique forte. Durant la guerre, entre 1992 et 1995, la ligne de front passait dans la cour du centre. L’armée de Bosnie-Herzégovine et l’armée croate se faisaient face ici-même. Vingt-deux ans après, les stigmates de la guerre sont encore visibles. Les bâtiments sont marqués d’impacts de balles, et des quartiers entiers sont laissés à l’abandon, donnant l’impression d’une ville fantôme sous certains angles. Aujourd’hui, l’espace culturel est un symbole de résistance face au nationalisme. Car Mostar reste une ville divisée politiquement. Depuis neuf ans, la ville n’a pas eu d’élections locales et le maire en place est illégitime.
Amar Maksumić, lui, est né dans un container qui faisait office d’hôpital à la fin de la guerre. Il est aujourd’hui technicien du son. Après une école d’électricien, le jeune homme a décidé de ne pas poursuivre ses études. Selon lui, elles « ne servent pas si tu n’as pas de bon contacts pour trouver un travail ».
Il souhaite désormais quitter son pays pour l’Allemagne, à contrecœur. « Le pays n’offre pas de choix à la jeunesse », confie-t-il. Anarchiste depuis toujours, « c’est de famille », le jeune homme lutte contre les nationalistes parce qu’« ils se sentent obligés de pointer du doigt les coupables ». Pour Amar, s’inscrire dans un groupe nationaliste permet d’avoir « un soutien financier du gouvernement ».

Amar Maksumić sur la rampe du skatepark du centre culturel Abrašević, Mostar, Bosnie-Herzégovine, 2017.
En 2014, Amar prend part aux révoltes sociales qui éclatent dans tout le pays. Le 6 février 2014, plusieurs centaines de personnes descendent pacifiquement dans les rues de Tuzla, dans le nord-est du pays, pour manifester contre le chômage et la pauvreté. La répression de la police met fin à la manifestation mais crée une réaction inouïe. Pendant plusieurs jours, des mobilisations ont lieu dans toutes les villes de Bosnie-Herzégovine. Des bâtiments administratifs et politiques sont brûlés et des assemblées citoyennes, les « plenums », sont créées. Pendant plus de deux mois, sur les places publiques, les gens se rassemblent et refont le monde, avec un profond désir de changement. Mais certains manifestants ont été menacés après avoir assisté aux assemblées. Le mouvement s’étouffe et entraîne avec lui les espoirs d’un éventuel changement. Et reflète chez les jeunes le sentiment d’être délaissés par le gouvernement. Amar, lucide, rappelle que « la politique bosnienne est la plus compliquée du monde ».
Depuis les Accords de Dayton, qui ont signé la fin de la guerre en 1995, la Bosnie-Herzégovine est partagée en deux entités. D’un côté, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui représente 51 % du territoire et 70 % de la population d’après les données du CIA World Factbook. De l’autre, la République serbe de Bosnie, dite Republika Srpska, qui se partage 49 % du territoire et 25 % de la population. Aujourd’hui, la présidence est assurée de manière tournante, tous les huit mois, par un représentant d’un des trois peuples constitutifs : Serbes (orthodoxes), Croates (catholiques), Bosniaques (musulmans). Au total, la Bosnie-Herzégovine compte 14 gouvernements et 180 ministres, pour près de 4 millions d’habitants. Aujourd’hui, face au manque de perspective d’avenir, Amar veut partir à l’étranger, plutôt que rejoindre un parti politique contraire à son opinion. « Ici, tu dois choisir entre être dans un parti et avoir un emploi, ou ne pas être dans un parti et ne pas avoir de travail », soupire le jeune bosnien.
Du bar-cinéma le Meeting Point à Sarajevo au centre culturel Abrašević à Mostar en passant par le Youth Theater de Tuzla, rencontre dans ces lieux culturels symboliques d’une jeunesse, qui ne se reconnait plus dans son pays.
À Sarajevo aussi, l’envie d’ailleurs reste très présente chez les jeunes. Arneld, 28 ans, grande, blonde, élégante, veut, elle, partir vers l’Australie. Avec pourtant un master en ingénierie civile, Arneld ne trouve pas de travail et vit grâce à son mari. « Ce pays ne m’offre rien », souffle-t-elle sur les rives de la rivière Miljacka. À ses côtés, Adelisa, 22 ans, est d’origine slovaque. À Sarajevo depuis deux mois après avoir rejoint son époux bosnien, elle a enchaîné les petits boulots et a prévu de partir en Allemagne « pour une vie plus stable ». Mubina, 23 ans, est née, elle, à Sarajevo. Elle étudie l’économie depuis trois ans mais ne pense pas trouver un travail parce qu’il y a « beaucoup de chômage ». La jeune femme attend elle aussi de finir ses études pour partir en Allemagne.
Pour ces jeunes bosniens, la politique « corrompue » anéantit les espoirs de possibles changements. Tout se vend et tout s’achète. Les diplômes comme le travail. « Si tu veux décrocher un job, tu peux payer quelqu’un 2 000€ à 2 500€, aussi bien dans la fonction publique que le privé », explique Amar. Alors, pour s’en sortir, Amar travaille au noir, comme « la quasi-totalité des diplômés qui ne trouvent pas de job ici ». Une situation qui lui permet tout juste de vivre. Selon l’institut fédéral des statistiques de Bosnie-Herzégovine, le salaire moyen s’établissait à 429 euros en 2014.
« Que va-t-on laisser aux jeunes ? »

Mickey tient fièrement les photos de son fils parti étudier en Allemagne. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, 2017.
À 66 ans, Mickey est un homme plein de vie, drôle et généreux. Il tient une auberge à Sarajevo pour se garantir une retraite convenable. Installé sur sa terrasse, avec vue sur son petit jardin fleuri, il parle de sa vision du pays et des problèmes auxquels il se confronte.
| Interview avec Mickey, Sarajevo, 2017. |
Aujourd’hui, vingt-cinq ans après le début de la guerre civile, la Bosnie-Herzégovine n’a pas fini de se relever. Plus de 60 % des jeunes sont au chômage. Le pays, toujours confronté à sa reconstruction d’après-guerre, est de plus touché par la crise de 2008. Selon la Banque mondiale, le PIB a diminué de 6,8% en 2007 à 0,8% en 2010. Cette forte chute de la croissance entraîne avec elle la fermeture des entreprises et un chômage de masse. Aujourd’hui, les employeurs sont réticents à embaucher des jeunes sans expérience et certains secteurs d’activité sont saturés. Un problème majeur puisque sans travail, les enfants dépendent financièrement de leurs parents et sont contraints de rester vivre sous le même toit, ce qui ne leur permet pas de se projeter dans une vie de couple ou de de famille. Une solution s’offre alors à eux : partir.
Selon l’étude Youth Study Bosnia and Herzegovina, publiée par la faculté de Sciences politiques de Sarajevo en 2015, 100 000 jeunes auraient quitté le pays entre 1995 et 2014. La destination phare pour les Bosniens est l’Allemagne, gros pourvoyeur d’emplois. L’Allemagne et les pays des Balkans de l’Ouest ont notamment signé un accord permettant l’embauche de 250 000 personnes d’ici à 2020 dans le secteur de la santé, d’après un article du Parisien.
Ainsi, le manque de perspective d’avenir, le chômage élevé, la corruption et le non-renouvellement de la classe politique créent une vulnérabilité chez les jeunes bosniens. Une fragilité chez les plus démunis dont peuvent se nourrir les islamistes radicaux, même marginalement. En 2016, le réseau de journalistes d’investigation des Balkans, BIRN, a publié une vaste enquête sur la radicalisation et le recrutement des combattants en Syrie et en Irak par l’auto-proclamé État Islamique. Dans un pays où l’Islam est de tradition modérée, le phénomène n’est pas massif, mais pose tout de même question.
Selon le BIRN, entre 2012 et 2015, 200 Bosniens ont rejoint les troupes de l’État islamique en Syrie et en Irak. Leur âge tourne en moyenne autour de 27 ans, selon Denis Džidić, rédacteur en chef du BIRN en Bosnie-Herzégovine et co-auteur de l’enquête. Sur ces 200 départs, trente d’entre eux auraient été tués dans le conflit, et 50 seraient revenus en Bosnie-Herzégovine. Le rédacteur en chef du BIRN déplore la passivité de la justice. « La loi est silencieuse sur ce problème », déplore Denis Džidić.
En 2014, le gouvernement a pourtant tenté de mettre en place une stratégie de sensibilisation dans certains villages isolés. Le but était de prévenir les risques encourus de rejoindre l’État islamique, notamment par des interventions dans les écoles. Il était aussi prévu de redresser la courbe du chômage, particulièrement fort dans ces villages, et de régler le problème de corruption. Mais cette stratégie n’a jamais été appliquée. À la place, le gouvernement a intensifié la surveillance et a multiplié le nombre de policiers. Ainsi, aujourd’hui, la radicalisation continue en Bosnie-Herzégovine, mais le processus a été affaibli par la fermeture des mosquées illégales et une plus forte répression gouvernementale.
« Les gens ne sont pas assez éduqués à la démocratie »
Ahmed s’installe dans un salon de thé moderne et cosy, loin du bruit ambiant de la ville. Autour d’une citronnade, le jeune homme étudiant en journalisme à Sarajevo, livre ses espoirs sur le parti dans lequel il s’investit.
À 21 ans, Ahmed Kosovac souhaite rester dans son pays et s’impliquer en politique. Le jeune homme décrit un pays divisé entre les différentes ethnies. Pour Ahmed, si les manifestations antigouvernementales, parties de Tuzla en 2014 ont pris fin, c’est parce que « les gens ne sont pas assez éduqués à la démocratie ». Aujourd’hui, les jeunes se désintéressent de la politique et regardent vers l’ouest pour leur futur. Éternel positif, Ahmed s’active pour espérer des changements. En rejoignant le parti Naša Stranka, « Notre parti » en français, l’étudiant en journalisme y voit une alternative. Fondé en 2008, Naša Stranka est un parti social-libéral pro-UE et pro-OTAN. Fondé par Danis Tanović, réalisateur oscarisé en 2002 pour son film No Man’s Land et Dino Mustafić, metteur en scène réputé en Bosnie-Herzégovine. Naša Stranka s’est néanmoins vu attribuer l’image d’un parti intellectuel et élitiste. Aujourd’hui, Naša Stranka se veut transparent et éthique. Leur combat principal étant la lutte contre la corruption.
Le parti ne cesse de grandir à l’approche des élections présidentielles de 2018, avec 5 000 membres constitués en majorité par des jeunes, selon Ahmed. Pour lui, contrairement à d’autres mouvements, ce parti « ne joue pas sur les ethnies pour augmenter sa popularité ». Selon Ahmed, les relations se tendraient entre les Bosniens. « S’ils continuent, on aura une nouvelle guerre », affirme le jeune homme. La seule solution possible pour l’étudiant serait l’intégration de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne, même s’il sait que « ça va être compliqué ». Officiellement candidat depuis 2016, le pays devra, selon les critères d’adhésion, renforcer son économie, améliorer son système politique et judiciaire et faire des efforts en matière de liberté d’expression. Ahmed n’attendra pas. Il envisage d’ores et déjà de partir faire une année d’étude dans l’Union Européenne.
Valentine Zeler (texte et photos), Orane Benoit et Mathilde Fiet (vidéo)