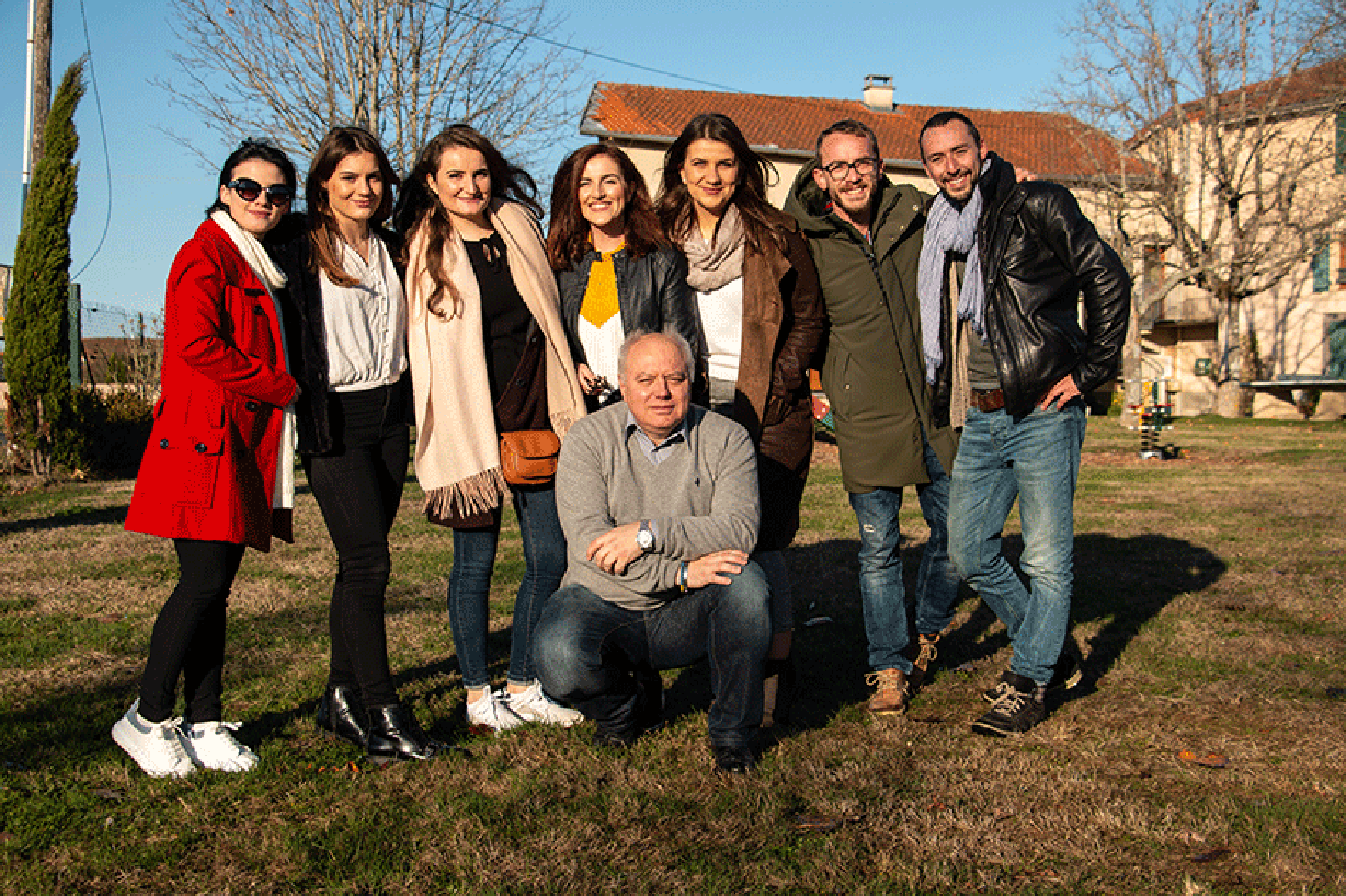Des visiteurs au plus près du conflit
Le 3 août 2014, le musée « In Flanders Fields » dans la ville d’Ypres en Belgique accueillait, comme à son habitude, des milliers de visiteurs. Seule différence : la commémoration du premier jour du centenaire de la première guerre mondiale.
Certains sont là par hasard, d’autres sont parfaitement conscients de l’enjeu de leur venue. Au milieu des groupes d’érudits, se distinguent quelques enfants, dont la fascination, qui les rend incroyablement silencieux, relève plus du mystère des lieux que du contenu. A l’entrée, de nombreuses discussions discrètes dans la langue de Shakespeare percent la musique ambiante troublante et pesante du musée, fil conducteur de l’horreur de la guerre tout au long de la visite. Cette musique, Christiane et Myriam, deux bruxelloises venues à Ypres pour la première fois, la définissent comme « calme et apaisante », une manière de contrer la cruauté de la guerre. Venus des quatre coins du monde, les visiteurs tentent d’entretenir une proximité avec un des plus grands conflits de l’humanité, grâce à la multitude de preuves et de confrontations avec la réalité. Tenues de combats, témoignages, affaires personnelles, casques, documents officiels et photographies trônent sur les murs sombres des trois salles ouvertes, divisant chacune le musée en un parcours précis.
Des éléments perturbants

Concentrés et interloqués, les visiteurs écoutent attentivement le récit du fugitif bruxellois. Crédit: Gilberto Güiza
« Incroyable ! », s’exprime une femme devant un immense tronc exposé en vitrine. Le chêne séculaire, abattu longtemps après le conflit porte encore les stigmates des impacts de balles. D’autres, plus attirés par la modernité, s’arrêtent devant les grands écrans. Sur fond noir, un personnage venu du passé raconte son histoire. Un homme aux allures de dandy, canne à la main, explique sa longue fuite à l’arrivée des Allemands dans son village de Middelkerke en Belgique. Richard Wybouw, c’est son nom, a tout perdu dans son évasion, sauf sa canne. Gravée des noms des villages qu’il a traversés, elle est le dernier témoin de son exil,« Quand on a fui, on est sûr de rien », conclut-il à la fin de son récit.
Un peu plus loin, ce sont des clichés morbides de soldats qui saisissent littéralement les visiteurs. A peine remis de leurs émotions, une voix triste les attire. Un personnage chante d’une manière lancinante la comptine de Noël « Stille Nacht, heilige Nacht ».
Sur l’écran, les soldats allemands, britanniques, français et belges se relayent chacun leur tour pour raconter leur nuit de Noël sur le front. Une nuit de réveillon extraordinaire. D’un coup, les soldats fraternisaient dans les tranchées où quelques heures avant, ils s’entretuaient.
Un sentiment étrange
Devant la vitrine des costumes de combats des différents soldats, Annie semble troublée. Venue en famille de Nantes, elle avoue « chercher à comprendre », s’y connaissant « beaucoup plus au sujet de la deuxième guerre mondiale ». Satisfaite de l’ambiance qui découle de sa visite, elle précise que « les enfants sont trop petits pour comprendre ce que tout cela représente ». Immergés au mieux dans le quotidien des tranchées, chacun peut comprendre la complexité de la guerre dans un environnement des plus contemporains, laissant place au sentiment étrange de (re)découverte de l’histoire de la Grande Guerre.
Marie Zinck